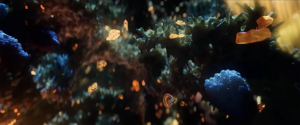Le film commence par un crescendo orchestral, la caméra filant par-dessus l’herbe luxuriante et se précipitant vers la protagoniste qui virevolte radieusement, filmée en ce champ vert sur fond de montagnes déchiquetées. S’ensuit un gros plan sur la star, Julie Andrews, qui nous gazouille que «les collines vivent au son de la musique,» les bras tendus de ravissement. Ici, seule au bord d’un ruisseau, parmi les arbustes, longeant le front d’une colline, cette étrange figure aux cheveux coupés court, vêtue d’une chasuble d’enfant, semble traverser une épiphanie, communiant avec la pureté des éléments: air frais, eau claire et brins d’herbe intacts.
En visionnant le film à nouveau, on sait que la montagne signifie bien plus que cela: elle représente une sphère supranationale idéalisée, loin de la politique et surtout,loin de la tyrannie. Le paysage élevé et isolé entourant Maria forme un contraste frappant avec la barbarie humaine que l’on trouve dans les vallées, qui regorgent de musique, oui, mais aussi de nazisme. Les collines sont aussi synonymes de simplicité, loin des problèmes de la religion, de la sexualité et de la politique: aucune décision à prendre ici, pas de camp à choisir. «Je vais dans les collines lorsque mon cœur est solitaire» entonne Maria en marchant sur l’horizon, filmée en contre-plongée. «Je sais que j’entendrai ce que j’ai entendu avant. Mon cœur sera béni par le son de la musique – et je chanterai encore.»
Cette idée de la montagne comme lieu de guérison, de réflexion et de récupération, comme endroit de bien-être spirituel et psychologique, n’est pas tout à fait moderne. Elle s’est toutefois répandue assez récemment. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les médecins britanniques recommandent à leurs patients de prendre l’air marin plutôt que de braver la montagne. Les cimes du Pays de Galles et du Lake District étaient appréciées davantage pour l’aventure qu’elles offraient à une nouvelle génération de touristes, ainsi que pour leur incarnation du pittoresque et du sublime. Plus tard, les grands sanatoriums d’Europe et des États-Unis ont vu le jour après la découverte en 1882 par Robert Kock du bacille à l’origine de la tuberculose. Ces lieux promettaient une mise en quarantaine, un design herméneutique et des tonnes d’air de montagne.
Un an avant cela, Heidi de Johanna Spyri incarnait le comble de la vie montagnarde. Sa protagoniste découvrait le bonheur avec les chevreaux errants au sommet des montagnes et se liait d’amitié avec les rudes habitants des collines, si simples et bucoliques. Quand Heidi est ramenée à Zurich, elle tombe malade au point d’apparaître fantomatique, et se trouve vite congédiée dans la montagne afin d’éviter une mort certaine. Là, l’enfant reçoit la visite de son amie infirme Clara, et l’invalide parvient miraculeusement à retrouver sa capacité de marcher. Le livre a été adapté en plusieurs séries télévisées, dessins animés et films, dont une version populaire avec Shirley Temple en 1937.
ll faut ajouter que les Alpes, représentant un terrain entre la France, l’Italie, l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne, ont en soi une signification politique numineuse. Ce logos liminal renvoie peut-être à l’apatridie que Maria trouve si envoûtante dans The Sound of Music.
C’est dans ce paysage que déboule Georges, l’anti-héros du Daim aussi macabre que délicieux de Quentin Dupieux. Dès que Georges nous est présenté, vers le début du film, essayant de se débarrasser d’un blouson dans des toilettes qui débordent, poussant avec une verve maniaque cette veste détestée au fond de la cuvette, on sait que c’est un homme qui a des problèmes à résoudre. On s’aperçoit de par quelques moments elliptiques superbes (messages de répondeur, ou autres informations glissées dans une conversation) que la femme de Georges a rompu avec lui. Il part alors pour la montagne afin de recommencer sa vie.
C’est ici que Dupieux nous joue un tour merveilleux, coupant l’herbe sous le pied du spectateur qui pourrait s’attendre à toutes sortes de banalités dans le genre de We Bought A Zoo: il fait sombrer Georges dans la folie. Ou plutôt: il fait repartir sa folie et son anomie dans de nouvelles directions alarmantes. Les vertus réparatrices de la montagne sont ignorées; l’idée de régénération est adoptée de manière perverse. Dupieux nous montre un homme malade, qui ne peut voir le monde autour de lui que comme une facette de son traumatisme. En cela, il rappelle les «Old Fools» de Philip Larkin, «accroupis sous l’Alpe de l’extinction (…) /ne percevant jamais / combien elle est proche.» Dans cet espace si beau et intemporel, Georges se fixe sur une veste en daim hideuse, ornée de divers pompons et franges grotesques, lui donnant l’air d’un cow-boy pathétique. Il se donne pour mission de devenir la seule personne au monde à posséder un blouson – tâche manifestement impossible, puisqu’elle implique de voler des vestes à des inconnus ou de dégommer des gens au hasard.
L’intelligence de Dupieux dans ce film est exceptionnelle. Bien que ce soit une histoire simple et un énoncé absurde, le réalisateur bouleverse l’idée insensée du tout-est-bien-qui-finit-bien: il ne se trouve aucune décision dans la vie de Georges qui pourrait provoquer une sorte de floraison après cette période de jachère. Bien au contraire, si Georges trouve une nouvelle vie ici, c’est une vie alarmante, vraiment folle – et la façon dont il s’y livre nous montre qu’il est vénal et sans morale, ainsi que profondément déconnecté. Dupieux s’amuse de ça: le village semble être figé dans une sorte de non-temps, les vêtements de Georges sont ringards, et on rit du manque de savoir-faire technologique de ce personnage confronté à divers gadgets rudimentaires.
Cette idée chamboule notre vision de la masculinité ou plutôt de la masculinité filmique, exprimée par un héros qui apprend et qui change. Dupieux nous montre quelqu’un qui a peut-être changé, mais qui est peut-être aussi en train d’approfondir ses pires tendances: paranoïa, tromperie, intrigue, vol. Voici un portrait cinglant et évidemment hilarant d’une masculinité devenue complètement malade.
Dupieux souligne cet aspect en donnant à Georges une associée: Denise, une serveuse beaucoup plus jeune que lui et étudiante en cinéma. Elle lui propose de monter les séquences que Georges a tournées avec sa caméra: des images de lui-même dans son horrible ensemble en daim, ou de Georges s’en prenant à des villageois qui auraient la malchance de porter un blouson dans ses parages. On voit dans quelle mesure Georges est prêt à escroquer Denise pour faire son terrible snuff movie – même si Denise est assez avisée pour voir à travers lui et qu’elle a également une certaine compréhension du monde et peut-être même un talent artistique. Si Denise est dupe de Georges, c’est à cause de son enthousiasme et de son désir de travail, d’excitation – non pas à cause d’une obsession dévorante, comme c’est le cas avec Georges. La capacité de Denise à se connecter contraste avec la façon dont Georges, lui, ne communique avec les gens que comme des aspects de sa propre maladie.
Bien sûr, Le Daim est une comédie – une comédie malade et absurde, certes, mais très drôle. C’est justement ce mode, rejetant la suffisance et le sérieux et embrassant plutôt une vision âcre du monde, qui fait de ce Daim une réplique si puissante à tous les clichés du genre. Le début du film provient en fait de son milieu: le film brouille les pistes entre le début, le milieu et la fin, suggérant que les humains ne «grandissent» pas.
La dernière scène du film, surprenante et hilarante, nous emmène en plein air, dans un champ d’un vert éblouissant, où Georges et Denise doivent filmer une scène pour leur film. Le choc meurtrier des événements qui suivent est d’autant plus jouissif et d’autant plus absurde qu’il a lieu dans cet environnement vierge. En fin de compte, ces collines vivent au son de meurtres violents, et Dupieux sifflera encore.
Deerskin. Directed by Quentin Dupieux, performances by Jean Dujardin and Adèle Haenel, Atelier de Production, 2019.
Larkin, Philip. “The Old Fools.” High Windows, Faber and Faber, 1974.
The Sound of Music. Directed by Robert Wise, performance by Julie Andrews, Twentieth Century Fox, 1965.
Spyri, Johanna. Heidi. Friedrich Andreas Perthes, 1881.
LE DAIM (2019) dir. Quentin Dupieux

CASPAR SALMON writer & translator
Caspar Salmon is a freelance journalist specializing in film and culture, with a particular interest in queer cinema and the way art reflects the politics of our time.
© Copyright for all texts published in Stillpoint Magazine are held by the authors thereof, and for all visual artworks by the visual artists thereof, effective from the year of publication. Stillpoint Magazine holds copyright to all additional images, branding, design and supplementary texts across stillpointmag.org as well as in additional social media profiles, digital platforms and print materials. All rights reserved.